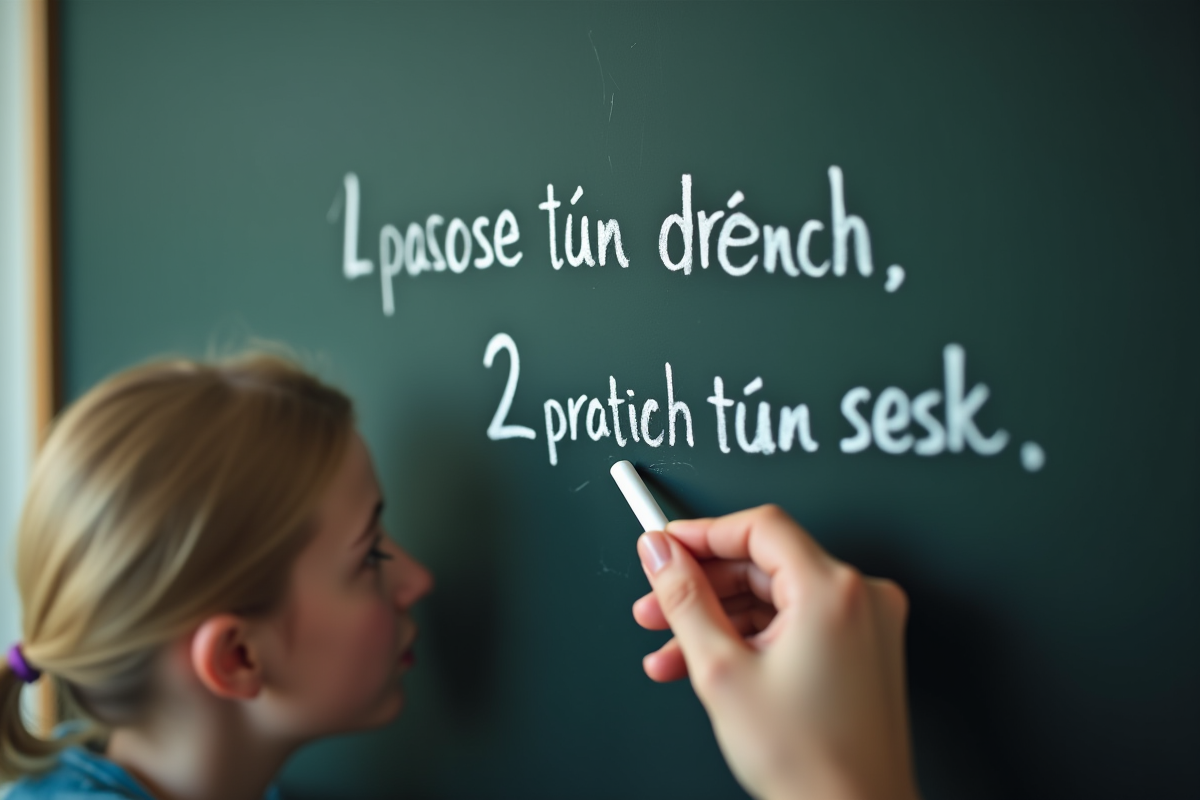Écrire « il a prit » n’a jamais été la marque d’un rebelle grammatical, mais plutôt celle d’un piège ordinaire dans lequel même des plumes aguerries finissent par trébucher.
Erreur fréquente : pourquoi « il a prit » est si répandu ?
La confusion entre « il a pris » et « il a prit » persiste, et pas seulement chez les débutants. Ce n’est ni de la distraction ni un simple manque d’attention, mais le résultat d’une habitude ancrée dans la mécanique du français. On croit suivre le bon chemin, guidé par le son, la logique, et soudain, la langue française rappelle qu’elle déteste les généralisations.
Si cette faute apparaît si souvent, c’est que les conjugaisons régulières, on pense aux participes en -é comme « il a mangé » ou en -i comme « il a fini », créent une routine. On finit par vouloir calquer ce schéma sur d’autres verbes, en oubliant les exceptions coriaces du troisième groupe.
Les causes de cet écueil sont multiples et bien identifiées :
- Des verbes comme « écrire » ou « dire » (« il a écrit », « il a dit ») sèment la confusion. La terminaison en -t existe bien, mais pour des raisons qui n’ont rien à voir avec « pris ».
- Les correcteurs grammaticaux ne repèrent pas toujours cette faute. Au final, rien ne remplace la vigilance humaine quand il s’agit de conjuguer des verbes du troisième groupe.
En voyant la faute revenir sans cesse sur les réseaux sociaux et dans les discussions en ligne, elle finit par s’ancrer dans la mémoire, presque comme une variante tolérée. C’est ce mimétisme qui fait durer cette forme fautive.
Quelle est la règle exacte pour choisir entre « pris » et « prit » ?
Aucun spécialiste du français n’a jamais validé « il a prit ». La distinction est simple : « pris » et « prit » n’occupent pas la même fonction, ni le même temps, ni le même contexte. « Pris » est le participe passé du verbe prendre, tandis que « prit » s’utilise seulement au passé simple, à la troisième personne du singulier. Ici, la règle ne laisse aucune place au doute.
- Pris accompagne toujours l’auxiliaire « avoir » au passé composé, dans une action accomplie qui a un effet sur le présent : « il a pris ».
- Prit n’a pas d’auxiliaire, il apparaît dans les récits au passé simple : « il prit le temps d’écouter ».
La différence s’efface à l’oral, mais à l’écrit, elle saute aux yeux. « Pris » peut s’accorder (« elle a pris », « ils ont pris »), mais « prit » reste parfaitement stable, réservé au passé simple, personnage discret mais à sa place dans le récit.
Pour éviter toute incertitude, isolez la structure de la phrase : présence de l’auxiliaire « avoir » ? Le choix s’impose : c’est « pris ». S’il n’y a aucun auxiliaire et que tout se passe au passé simple, alors « prit » est le verbe recherché. Appliquer cette règle, c’est éliminer les hésitations une fois pour toutes.
Des exemples concrets pour ne plus jamais hésiter
Pour illustrer cette différence, rien ne remplace des exemples précis. C’est par la répétition concrète que la bonne orthographe s’ancre.
- Il a pris sa décision rapidement. Pastille de passé composé : auxiliaire « avoir » + « pris ».
- Elle a pris la parole dès le début de la réunion. Même construction, juste un accord en plus.
- Dans un récit, il prit son manteau et sortit. Le passé simple, sans auxiliaire, marque le coup d’envoi d’un autre temps d’écriture.
Un réflexe simple aide à éviter la faute : vérifiez la présence de l’auxiliaire. S’il s’agit du passé composé, c’est impérativement « pris » qu’il faut écrire. On peut vérifier par substitution avec « mis » : « il a mis » paraît naturel, alors que « il a mit » choque aussitôt l’œil avisé.
D’autres verbes du même groupe illustrent la règle : on écrit « il a écrit », jamais « il a écris ». Cette mécanique, répétée, protège des fautes d’inattention et affine la justesse de l’écriture.
Astuce simple pour mémoriser la bonne orthographe au quotidien
Ce n’est ni sorcier ni réservé aux grammairiens : le plus efficace reste d’associer « prendre » à ses cousins du troisième groupe, et d’en comparer les formes au passé composé. L’œil et l’oreille finissent par reconnaître le piège.
- Quelques comparaisons utiles : Il a pris, il a mis, il a dit, aucun « t » final pour ces participes passés-là.
- Si le doute persiste, tentez la substitution avec « lu » ou « fait » : on écrit naturellement « il a fait », jamais « il a faitt ».
Lecture attentive de textes fiables, exercices réguliers et observation des règles permettent à la distinction de s’installer durablement. À répéter, imiter, relire, la bonne forme finit par s’imprimer et la tentation d’y glisser un « t » ne devient plus qu’un souvenir lointain.
Chaque fois que vous hésitez, pensez à cette mécanique. L’habitude se forge et, au fil du temps, la bonne orthographe de « il a pris » deviendra naturelle, comme un automatisme. Il ne restera plus, alors, qu’à sourire devant l’erreur, celle que l’on repère d’un coup d’œil, mais que l’on ne commet plus.